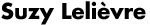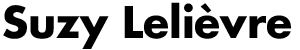Valérie Toubas et Daniel Guionnet
Mars 2022. Entretien pour la revue Point contemporain #24
Les sculptures de Suzy Lelièvre dessinent dans les espaces où elles sont placées - paysages routiers ou urbains, forêts - des entités parasites, des brouillages de sens, des signes singuliers, humoristiques et poétiques qui capitalisent le regard. La notion de perception, qui est au cœur de sa pratique, doit être entendue comme un processus de réalisation et par là-même de révélation progressive. Parcourir plusieurs années du travail de recherche de Suzy Lelièvre donne à voir cette capacité à mettre en relation, à opposer ou à extraire, dans un environnement, ce qui en matière de surfaces et de lignes, le fonde, met à jour une géométrie structurelle et structurante. Toute forme nécessite une approche méthodique voire naturaliste dans le sens où toute recherche passe par l’observation, la mise en concordance, le recensement et enfin la consignation de conclusions. Suzy Lelièvre procède dans une tradition qui est tout autant scientifique que philosophique. Des recherches qui ne sont pas sans rappeler l’approche d’un André Lhote dans Traité du paysage ou encore l’Esthétique des proportions de Matila C. Ghyka, et de manière plus contemporaine l’étude des fractales de Mendelbrot. Mais dans son approche de plasticienne, observer et étudier ne suffisent pas, comprendre non plus, il est devenu impératif de toujours faire évoluer d’une étape supplémentaire le résultat obtenu afin de multiplier les points de vue. Le dessin se dote d’une nouvelle destination pour devenir l’expression d’une forme évolutive, complexe et multiple. Il se fait aussi l’accomplissement du projet d’exploration le plus difficile à atteindre, qui est sans doute de se fondre soi-même dans une prospective sans fin et de l’accepter comme telle pour, d’une certaine manière, appartenir à ce que l’on regarde.
Comment s’organise ta production plastique qui prend des formes très diverses, sculpture, dessin ?
L’essentiel de ma production, liée à la sculpture, porte sur le déploiement d’une dimension à l’autre, du plan à la tridimensionnalité. Le dessin tient une place importante, en tant qu’outil de construction de figures en lien avec l’espace, même si pendant longtemps, j’ai tenu ce médium à distance du regardeur. Le salon du dessin PARÉIDOLIE a été déclencheur pour assumer les esquisses en tant qu’œuvres et considérer le papier comme un matériau à part entière : comment appréhender cette surface ? Par découpage, par collage, par le pli ? Dans une première approche, je façonne le papier par des gestes proches du travail de marqueterie, en assemblant des feuilles bord à bord. La préparation des pièces nécessite plusieurs étapes, croquis, teintures, découpes, qui engagent un rapport au temps et à la précision. Une seconde approche porte sur la mise en volume du papier. Le projet Boites-fantômes (2018) traduit ce cheminement du plan au volume qui lui-même dessine des tracés sur le plan.
Ce qui signifie que les dessins exposés à PARÉIDOLIE, s’ils étaient ôtés de leur cadre, pourraient être dépliés pour former des volumes ?
En effet, plusieurs dessins comme Rooms (2020), étaient perçus sous une forme complètement écrasée. Cette pièce est, en réalité, un volume plaqué sur la surface plane pour répondre à la contrainte de présentation. Elle fait référence aux principes d’enchevêtrement que les designers Charles et Ray Eames développent dans leur jeu House of cards (1952). Je reprends et déplace leur geste pour générer des espaces qui peuvent se développer ou se rétracter à l’infini, comme la sculpture Rooms (2020) éponyme, qui est constituée d’un assemblage de découpes en mdf. N’est-ce pas là une réflexion sur l’espace et le temps, sur un des aspects de la Relativité ? Toute ma réflexion artistique est portée par la question de la déformation. Comment dilater ou étirer le temps, comment générer des espaces courbes ? N’ayant pas de formation scientifique, je suis toutefois émerveillée par les structures emblématiques liées à la géométrie non-euclidienne, et plus précisément la topologie. Je travaille avec ce que je peux comprendre de ces théories complexes, et j’utilise des structures universelles comme le ruban de Möbius, qui n’a qu’un seul côté (Hôtel Moebius, 2017), ou le plan projectif de Werner Boy. Composée de trois maisons qui s’interpénètrent, la pièce Boycube house (2021) est l’exemple d’une adaptation de cette théorie. Il est possible de circuler à l’intérieur, comme dans un tunnel. Dans Armilles (2020), les anneaux enchâssés figurent trois globes reliés pour former un ensemble, révélant des possibles voûtes concaves et convexes, des espaces à la fois intérieurs et extérieurs, déplaçant les axes de révolutions et les centres de gravité. Il est aussi question de cosmos dans la manière dont j’ai procédé pour faire ce dessin, constitué de papier teinté, découpé et collé sur une feuille blanche. L’encre est d’abord déposée à grandes eaux sur le papier. En séchant, la surface laisse des zones plus ou moins denses. Cette fluidité me renvoie à la voûte céleste, dans laquelle le regard peut plonger. Qu’ils soient élémentaires ou labyrinthiques, ces espaces topologiques possèdent leurs propres logiques, tels des organismes autonomes. Je tente d’en saisir l’essence.
Quel a été le cheminement de cette recherche sur la 3D ?
Il a pris des orientations différentes au gré de mes études. En école d’art, à Nîmes puis à Lyon, j’ai longtemps consacré ma pratique au seul détournement d’objets. Pendant ces années, mes recherches étaient menées de manière assez frontale. J’étais alors attirée par la question des moyens de production, notamment les objets issus de l’industrie et la notion de reproductibilité. Tout cela était perturbant car, en tant qu’artiste, je croyais qu’ils étaient à l’opposé de ce que je pouvais faire avec les moyens du bricolage. J’ai voulu m’initier à la réalité de la création industrielle en suivant des études à l’ENSCI – Les Ateliers. Le passage dans cette école a permis de trouver des espaces de création en connexion directe avec des fonctions concrètes, dans des contextes très différents. Mon intérêt s’est déplacé hors de l’objet pour se recentrer sur sa mise en relation sous divers angles que sont la modularité, la combinatoire et le jeu. Cette expérience m’a amené à identifier des problématiques qui sont encore au cœur de ma pratique comme les questions de la déformation, de la perception, de la réaction en chaîne. Le design m’a aussi enseigné à faire peu, à exprimer l’essentiel, dans une économie de geste.
Comment s’expriment la modularité, la combinatoire ou encore le jeu dans ta production ?
Mon processus de travail consiste, la plupart du temps, à créer et à revisiter des principes génératifs de formes à partir d’une matrice. Cela donne lieu à des séries, dans lesquelles sont combinés différents gestes de déformation : rotation, répétition, etc. En fonction de ces contraintes, les éléments prolifèrent et se complexifient. L’idée est de créer des formes qui jouent avec l’aléatoire, le sensible. Certains dessins présentés à PARÉIDOLIE portent sur des pavages projetés sur des espaces tridimensionnels. Ils s’appuient sur les recherches de Sébastien Truchet, un scientifique du XVIIIe siècle, qui a théorisé des combinaisons de pavage, que l’on retrouve dans tous les arts depuis très longtemps. J’utilise une version étendue de ces assemblages, en insérant les motifs de l’arc de cercle et du carré qui sont présents dans tous mes travaux, comme pour les projets Truchet (blue Velvet), Truchet (white) (2019). Carrés et arcs de cercle se rajoutent et se superposent les uns sur les autres, sont projetés dans l’espace puis remis à plat. Ces constants allers-retours contribuent à faire évoluer les formes étudiées, chacune des étapes devenant matricielle pour la suivante.
Comment s’est inscrite cette méthodologie, cette dimension rationnelle très précise dans ta pratique, par la lecture de traité comme ceux d’Alberti, ou de Brunelleschi ?
Sans être une spécialiste, je suis lectrice et praticienne de ces théories issues de la Renaissance. Ma méthodologie est imprégnée par un intérêt pour la perspective, la cartographie et une fascination pour les instruments de mesure et autres solides de Platon. J’utilise également l’axonométrie pour représenter les espaces. Cet outil de projection, qui se construit avec des parallèles, m’intéresse en tant qu’idéal de maîtrise, affranchi du point de vue et des échelles. La pratique de déformation agit comme une tactique pour interroger ces outils de représentation qui ont préfiguré l’industrie et participé à l’instrumentalisation du vivant. J’essaye de partager ces questionnements et cette méthodologie dans mes enseignements à l’école de Beaux-Arts de Sète. La pédagogie influence ma pratique, elle m’apprend à décomposer chaque étape du travail dans un cheminement où tous les gestes peuvent être énumérés et détaillés. Travailler avec différents publics rend aussi possible la rencontre avec des nouveaux territoires de création. L’an dernier, j’ai ainsi eu l’opportunité d’une résidence avec le Centre d’art Le Lait à Albi, dans laquelle j’ai travaillé auprès de six collèges, un centre de formation d’apprentis et des entreprises d‘extraction et de transformation de granit. J’ai pu ainsi produire des formes nouvelles dans ce matériau, en lien avec l’apesanteur, la fluidité. Cette géométrie organique tend à donner une nouvelle direction à mon travail.
Quelle place tient le numérique dans ton travail de dessin, notamment dans ta recherche sur l’organique ?
Ma pratique s’appuyant sur des logiques combinatoires, j’utilise volontiers des machines-outils et certains dessins peuvent être exécutés au stylo par un bras piloté afin de gagner en précision. Néanmoins, je ne fais pas de programmation informatique car j’ai besoin de générer par moi-même chaque nouvelle forme. La matérialisation des sculptures répond également à une volonté de passer par le geste, par aller-retour entre le cerveau et la main. La technologie agit comme garant d’une géométrie idéale, que je m’évertue ensuite à subvertir jusqu’à faire émerger des morphologies organiques. Beaucoup de mes pièces sont conçues à partir de ce geste d’étirement et de lâcher prise. J’essaye en permanence d’instaurer un dialogue entre les entreprises menées par l’homme et le vivant. Ainsi, pour L’espace d’une courbe (2020), œuvre pérenne au Vallon du Villaret en Lozère, j’ai créé une structure aérienne, suspendue dans des arbres, immergée dans la forêt. Selon les saisons, la météo et les points de vue, l’œuvre disparaît ou au contraire vient travailler en rupture avec ce qui l’entoure. Dans cette continuité, je prépare actuellement une nouvelle pièce, commandée par le Frac Occitanie Montpellier, pour la bibliothèque du lycée de Limoux. Baignée par la lumière naturelle, cette sculpture aérienne et ajourée, par la finesse de ses arêtes, dessinera des ombres fébriles qui se déploieront sur les tables de lecture et évolueront au fil du temps.