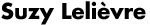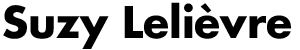Marion Alluchon
Septembre 2010
Dans nos cauchemars les plus effrayants, il arrive souvent que les objets se distordent et se transforment en obstacles menaçants. C’est en tous cas la première référence qui me vint à l’esprit lorsque je découvris le travail de Suzy Lelievre, et en particulier son œuvre Toboggan (2008), dont la rampe vert chewing-gum s’est enroulée en son centre formant un nœud qui en empêche la descente. Accentué par le fait qu’il s’agit d’un jeu pour enfants, c’est comme si le toboggan, en dénigrant la rigidité de son matériau, s’était rebellé, et était devenu non plus un objet amical au service de l’enfance mais un monstre prêt à attaquer nos innocents bambins.
Les Chaises en vrille (2009) ou l’Echafaudage (2008) peuvent être vus de la même manière. Dans la première, les lamelles en acier de l’assise d’agréables chaises de jardin se déploient en volutes tranchantes empêchant quiconque de s’asseoir. Dans la seconde, les pattes sur roulettes d’un échafaudage se courbent, entreprenant une gracieuse mais périlleuse danse, et rendant l’objet absolument impraticable sous peine d’accident.
Cependant, si ces objets retors ravivent des angoisses inconscientes, leur élégance confine également à l’émerveillement. Que les objets aient été réalisés ou qu’ils n’existent qu’à l’état d’images numériques ou de maquettes, ces archétypes du design quotidien deviennent, sous le génie créateur de leur auteur, les personnages fantaisistes d’un monde parallèle au sein duquel ils auraient le premier rôle.
Certaines pièces évoquent ainsi la grâce de corps en mouvement. Tandis que deux tables en bois et contreplaqué se superposent amoureusement, évoquant à la fois une portée de danse ou un accouplement (Deux tables, 2009), dans Contorsions (2010), les tables se tordent et se distordent avec l’élasticité d’un gymnaste. L’Echelle (2006-2008) s’assouplit comme une coquille d’escargot et le verre de Verre et bouteille (2009) se laisse langoureusement pénétrer par le goulot de la bouteille.
Si l’inversion du rigide et du mou, du plan et du courbe n’est pas nouveau dans l’art, Suzy Lelievre lui donne une fonction particulière. On pourrait par exemple rapprocher ses sculptures de celles, récentes, de l’artiste autrichien Erwin Wurm telles le camion plié à 90 degrés (Truck, 2007, Lyon) ou le bateau faisant mine de s’écouler du ponton sur lequel il a été abandonné (Misconceivable, 2009, Estuaire de Nantes). Mais à l’inverse de ce dernier dont les sculptures peuvent faire l’effet d’une blague, manifestant au passage la prouesse technique dont elles sont l’admirable résultat, Suzy Lelievre dramatise ses objets en leur donnant une attitude humaine.
Conçues par associations d’idées, les œuvres de Suzy Lelievre ne manquent souvent pas d’humour : ainsi l’éponge sculptée en forme de cerveau (Cerveau éponge, 2003), le papier peint au motif de moustiques écrasés (Les moustiques, 2007) ou le mini baby-foot composé de cuillères et de fourchettes en plastique sur nappe de pique-nique à carreaux rouges et blancs (Repas de famille, 2001).
D’autres intègrent des thématiques plus sérieuses. Après les toasts « réservés » que l’artiste dissémine dans les vernissages d’exposition pour se moquer du caractère faussement populaire du monde de l’art contemporain (2002), le Dispositif de protection muséal (2004) interroge le statut de l’œuvre d’art. Dans ces pièces en plâtre, ce sont les éléments copiés du dispositif de protection muséale qui deviennent, au lieu de la protéger, l’œuvre d’art elle-même. Elles-mêmes non protégées, au point que plusieurs d’entre elles ont été détruites par des visiteurs ne résistant pas à la tentation de les toucher, leur fragilité et leur caractère éphémère remettent en question la notion d’œuvre d’art éternelle et par suite, d’œuvre d’art comme potentiel objet de spéculation financière.
Au même moment, Suzy Lelievre passe du musée à la vitrine en réalisant Grille de magasin (2004), répliques parfaites de grilles de magasins lyonnais fabriquées en papier blanc soigneusement ajouré. Comme dans la pièce précédente, l’objet qu’est censée protéger la grille disparaît au profit de ce qui l’indique et le justifie habituellement comme objet de valeur. Directement associées à l’espace urbain, ces pièces délicates peuvent se lire comme une critique de l’accroissement du système de protection, dans une société administrée par une politique s’employant à exacerber un climat d’insécurité. Elles peuvent aussi, par la finesse du papier, évoquer des moucharabiehs ou les précieuses dentelles de pierre qui décorent certaines vieilles mosquées telles la Medersa Ben Youssef à Marrakech. Reproduisant à la fois un objet du mobilier urbain destiné à protéger l’économie marchande et un objet qui, depuis la nuit des temps, est également utilisé pour séparer le sacré du profane, ces œuvres invitent à reconsidérer la place laissée dans notre société au sacré, fût-il même séculaire.
Mais au-delà du caractère ludique ou de la lecture critique que l’on peut faire de ses œuvres, le travail de Suzy Lelievre est également intéressant dans la manière dont elle utilise l’objet industriel. Si l’artiste n’est pas la première à s’émerveiller des productions manufacturées, elle propose, à l’ère de la postmodernité, une nouvelle manière de les traiter artistiquement. Ce n’est pas en effet en en faisant des assemblages inattendus tels les ready-mades de Duchamp et de ses suiveurs qu’elle procède. Ce n’est pas non plus en mettant en exergue leur éventuelle ressemblance avec autre chose comme chez les surréalistes ou, plus proche de nous, chez des artistes comme Kader Attia qui transforme les réfrigérateurs en tours HLM (Fridges, 2006) et les armatures de parapluie en une nuée d’araignées (Sans titre, 2006). Suzy Lelievre se sert de l’objet industriel comme d’un matériau, tel un sculpteur traditionnel se servirait de la pierre, du bronze ou de la terre. Après la conceptualisation de l’œuvre à partir de ce que l’objet lui inspire, le travail qui suit est un travail de déformation de la matière même de l’objet industriel.
Déjà lorsqu’elle était étudiante à l’Ecole des Beaux-arts de Nîmes, l’artiste s’était employée à copier les modes de production industrielle jusqu’à en incarner les processus. Youpi(2002) est par exemple un carnet de 52 pages à grands carreaux dont elle s’est amusée à faire exploser quelques lignes, « imitant le dérèglement pourtant improbable d’une machine ». L’année suivante, elle incarne le travail de la machine en reproduisant à main levée et au prix d’une grande discipline et d’une « rigueur d’automate » une feuille agrandie de papier millimétré (Papier millimétré à main levée, 2003). Archétypes de la mécanisation, la feuille à grands carreaux ou le papier millimétré se trouvent ainsi « démesurés », laissant place à un chaos qui, s’il représenterait une erreur à l’usine, représente ici l’espace créatif libéré des entraves de la production mécanique. Renversant l’évolution technique, Suzy Lelievre part de l’industriel pour réintroduire l’artisanal dans la fabrication de l’œuvre-objet. En mimant le fonctionnement de la machine, elle aliène volontairement son corps pour réaliser des œuvres qui puissent révéler la part de hasard et de « raté » propre à l’être humain. L’écart produit entre l’objet industriel et l’objet unique réalisé à la main par l’artiste est ce qui permet à l’objet banal de devenir une œuvre authentique. Des œuvres qui, à l’instar du Papier millimétré, semblent vibrer.
Si Suzy Lelievre tentait donc de concurrencer la machine, ses pièces aux matériaux fragiles telles les Dispositifs de protection muséale, les Grilles de magasin ou Usage unique en pâte alimentaire (2004) témoignent d’une volonté de défier la matière même. Choisissant d’exploiter les faiblesses du matériau plutôt que ses forces, elle opère à l’inverse de tout producteur industriel qui, pour des questions de rentabilité économique, se servira plutôt des forces du matériau. Ainsi revient-elle véritablement à un travail de sculpteur pour lequel il est question de mettre la matière au défi et d’essayer de la faire accoucher d’une forme. Même lorsqu’elle reproduit l’objet industriel, l’artiste ne crée pas un énième objet industriel - ses pièces étant non reproductibles en série au demeurant - mais une sculpture nécessitant un talent manuel certain. Un travail un peu maniaque parfois, mais difficile et talentueux qui, alliant sans préjugé l'ancien et le moderne, devient particulièrement contemporain.